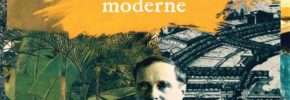Introduction de l’ouvrage de Benoît Lambert intitulé « Cyclopolis, Ville nouvelle – Contribution à l’histoire de l’écologie politique » (Georg Éditeur, 2004).
Comment le mouvement qualifié ici de «cyclo-écologiste», contre les abus de la circulation automobile et pour un nouvel urbanisme, participe-t-il d’un nouveau paradigme, celui de l’écologie politique? Qui en sont les acteurs et comment réagissent les instances politiques de l’État? Comment la bicyclette est-elle devenue le symbole d’une mobilité durable, et au-delà, d’un certain rejet du productivisme dominant? Ce mouvement s’inscrit dans un débat séculaire sur les avantages et les inconvénients de la vie citadine et campagnarde, mais quelle contribution apporte-t-il aux controverses, souvent passionnées, sur l’urbanisme actuel?
En tentant des réponses à ces questions, nous voulons démontrer que parmi les nouveaux mouvements sociaux contestataires[1], le mouvement pour la modération de la circulation automobile et pour une écomobilité[2], ignoré jusqu’ici par les sciences sociales, et en particulier par les sciences politiques – quand ce n’est pas par les études urbaines elles-mêmes – est un élément essentiel de la vie politique contemporaine et s’inscrit dans son histoire. Comme question liminaire, il convient d’établir ce qui distingue l’écologie politique d’autres doctrines politiques réformatrices. Selon Alain Lipietz l’écologie politique se heurte aux thèses socialistes essentiellement sur un point: ses membres ne sont pas, a priori, ou à tout prix, des promoteurs de la croissance économique. «Alors qu’au début du capitalisme industriel, médecins hygiénistes et syndicalistes font naturellement alliance (…) un ‘syndicalisme de la feuille de paye’, prêt à accepter une régression sur la qualité de la vie, en échange de pouvoir d’achat», sonne le glas de cette alliance[3]. Le mouvement pour la promotion de la bicyclette comme moyen de transport et pour la modération de la circulation automobile s’inscrit clairement dans cette mouvance, devenue depuis une vingtaine d’années une véritable force politique.
Dans son histoire, le mouvement écologiste connaît deux grandes tendances: celle de l’écologie naturaliste, donnant naissance sur la scène politique au mouvement conservationiste, dont Théodore Monod en France et Robert Hainard en Suisse étaient des représentants, et celle de l’écologie sociale illustrée par les écrits de Murray Bookchin, et dont la promotion de technologies appropriées est une revendication constante. Les relations socio-économiques de notre espèce constituent l’essence de cette nouvelle doctrine politique, puisque ces relations déterminent l’impact entropique de l’homme sur la nature. Nous défendons ici la thèse selon laquelle le mouvement pour la promotion de la bicyclette comme moyen de transport et pour la modération de la circulation automobile s’inscrit dans l’histoire de la critique des sciences et des techniques, dans l’histoire de l’écologie politique, et, ce faisant, dans l’histoire des doctrines politiques. Les bénéfices, ou les coûts externes, de la promotion de l’un ou de l’autre moyen de transport sont devenus trop importants pour que leurs promoteurs prétendent à une neutralité politique. Dans le domaine de la mobilité, comme dans bien d’autres domaines, l’époque du laissez-faire semble révolue: la «maîtrise de la mobilité» est exigée par les défenseurs de l’environnement et de la qualité de la vie en milieu urbain, au point d’en faire un enjeu politique majeur.
Selon les écologistes (partis politiques, associations ou intellectuels engagés), la multiplication du nombre de voitures nuit à l’environnement naturel et construit. Les plus défavorisés de la société, moins pourvus de ressources pour s’isoler de ses désagréments, ou pour faire face aux changements planétaires auxquels l’automobile contribue, sont particulièrement affectés par ses effets. Ce courant de pensée tente de montrer les dangers d’une technocratie cachée derrière une pseudo-rationalité pour assurer le triomphe de ses intérêts – une thèse défendue par Habermas dans La technique et la science comme idéologie, déjà en 1968. Peut-être mieux que tout autre réseau militant spécialisé, le mouvement pour la modération de la circulation automobile illustre un des socles philosophiques de l’écologie politique: son antiproductivisme – certes plus près de la frugalité que de l’ascétisme – mais réel, est un véritable questionnement de la société de consommation. Contre ce qu’il convient d’appeler «l’automobilisme politique»[4] s’appuyant sur des énergies fossiles bon marché, non renouvelables et induisant une dépendance politique (menant à des alliances plus que compromettantes pour les démocraties), le mouvement pour la modération de la circulation fait de la mobilité douce et autonome un des combats politiques contre ce que ses partisans qualifient très largement de «néo-libéralisme économique».
Bien que l’intégration d’une politique d’écomobilité à l’aménagement du territoire soit un des sujets parmi les plus débattus dans la presse, ou par votations directes en Suisse et dans certains États américains, très peu d’études se sont intéressées à son histoire. Qui en sont les acteurs, et comment – submergées de voitures que sont nos villes – pouvons-nous affirmer qu’une certaine acceptation institutionnelle des arguments du mouvement s’opère? Quelles sont les sources intellectuelles de ce mouvement? Enfin, le mouvement pour la modération n’est-il pas destiné à épouser une approche plus large de sa problématique, comme celle du Congrès pour un Nouvel Urbanisme né aux États-Unis? Ce dernier nous apparaît en effet comme une organisation faîtière toute désignée.
Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons retracé les évolutions marquantes et les particularités de ce mouvement. Multidisciplinaires, ses protagonistes s’intéressent autant à la qualité de la vie des citadins liée aux nombreux enjeux de la mobilité (échelle micro d’une sociologie politique urbaine), qu’à la santé de la Biosphère dont l’humanité dépend pour sa survie (échelle macro des sciences de la Terre). Sur ce dernier point, nous proposons d’exposer les arguments empruntés à l’écologie scientifique, et en particulier aux sciences de la Terre, pour légitimer le pouvoir d’hommes et de femmes désireux d’orienter la politique des transports à l’échelle locale, nationale ou internationale, en tenant compte de son impact sur l’environnement naturel.
Débutant dans les années cinquante par des protestations contre le projet d’une traversée de la cinquième avenue de Washington Square Park à New York, ou contre la construction d’autoroutes suspendues à San Francisco puis dans le French Quarter à la Nouvelle Orléans, nous affirmons que le mouvement pour une écomobilité – et en particulier le très militant mouvement cycliste – est à l’origine, et participe d’une vaste redéfinition de l’urbanisme issu de la motorisation de la mobilité individuelle au XXe siècle et de la rationalité d’urbanistes adeptes du «style international» (Le Corbusier, etc..). Ses premiers succès sont la renaissance du tram dans de nombreuses villes, l’aménagement de réseaux cyclables, et la participation de sept cent soixante-sept villes européennes en septembre 2000 à la journée «En ville sans ma voiture». Deux ans plus tard, le dimanche 22 septembre 2002, elles seront 1300 dans le monde à participer à l’événement…
Véritable retour à un urbanisme vernaculaire et organique, les éléments visibles de cette révolution révèlent une certaine renaissance de l’urbanisme traditionnel tournant le dos à un siècle ivre d’un urbanisme moderniste, rationaliste et caractérisé par l’hypermobilité. Promu par le Congrès pour un Nouvel Urbanisme, le retour à une architecture monumentale et à un urbanisme dit culturaliste (selon la classification de Françoise Choay[5]) en réponse au progressisme rationnel le corbusien et à l’étalement urbain, constitue une véritable idéologie désignant l’esthétisme, l’espace, la mobilité, l’environnement naturel et construit, comme des enjeux politiques. On y parlera «d’accès» plutôt que de mobilité, «d’activités économiques» plutôt que de croissance (Kunstler), de «places publiques» et de «rues» plutôt que de couloirs à circulation pour motorisés, motorways. L’aménagement sera régional (Mumford) et organique (McHarg, Design with nature), mais son assise architecturale s’inspire de traditions millénaires.
Souvent inspirés par leurs observations en Europe ou dans des villes construites au XIXe siècle en Amérique, une nouvelle génération d’urbanistes américains affronte aujourd’hui la «géographie de nulle part», ses grandes surfaces commerciales et ses bretelles d’autoroutes. L’urbanisme[6] «classique» et vernaculaire renaît. L’automobile est tolérée dans ces villages et ces quartiers dessinés par le nouvel urbanisme, mais elle n’en définira plus les contours. Les femmes et les hommes, les jeunes et les vieux, les piétons, les cyclistes et les «trottineurs» s’en chargeront. Ces derniers revendiquent aujourd’hui un plus grand contrôle du «pouvoir caché» de la mobilité.
La bicyclette devenant le mode de transport individuel de référence pour fixer la nouvelle répartition de l’espace urbain et la vitesse des déplacements, la ville dont le rythme est fixé par la technologie du pédalier semble avoir de beaux jours devant elle. Déterminant le nouvel urbanisme de ces villes, nous proposons, en référence à une ville modelée par cette mobilité, de parler d’une « cyclopolis ». Le vélo, et les caractéristiques de ce choix modal, y structure la voirie; il y détermine le type d’investissements, et la vitesse des déplacements. S’appuyant en partie sur tous les modes de transport dits lents avec de faibles coûts externes – marche, vélo, trottinette –, la «cyclopolis» se caractérise par une convivialité urbaine que l’automobilisme spatiophage actuel rend difficile.
Benoît Lambert
Cyclopolis, Ville nouvelle
Contribution à l’histoire de l’écologie politique
Collection Stratégies énergétiques. Biosphère et Société – 284 pages ISBN 2-8257-0870-4
Editeur : Georg Éditeur (2004)
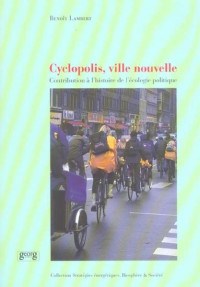
Notes
- Selon les définitions élaborées dans les articles: McAdam, Doug, Tarrow, Sidney, Tilly, Charles (1998), «Pour une cartographie de la politique contestataire», Politix, Revue des sciences sociales du politique, n°41, Paris, pp.7-32; Kriesi, Hanspeter, Koopmans, Ruud, Duyvendak, Jan Willern, Guigni, Marco (1995), The Politics of New Social Movements in Western Europe. A comparative Analysis, Minneapolis, University of Minnesota Press.
- A notre connaissance, ce terme apparaît en 1985 en Suisse avec la publication par Jean-Claude Hennet et l’Association Transports et Environnement de Ecomobile – Sortir de l’impasse des transports. Nous utilisons indifférernment dans ce travail les expressions «pour une écomobilité», «contre les abus de la circulation automobile» ou «pour la modération de la circulation automobile».
- Lipietz, Alain (1999), Qu’est-ce que l’écologie politique? La grande transformation du XXIe siècle, Paris, La Découverte, p. 55.
- «L’automobilisme politique» connaît certainement son paroxysme dans les grandes villes américaines chaque année davantage dominées par l’automobile. Mais la Suisse verra pour sa part naître un véritable Parti des automobilistes associé à la droite extrême. Dans le chapitre d’un ouvrage sur l’extrême droite en Europe, Pierre Gentile et Hanspeter Kriesi situent le Parti des automobilistes suisse, devenu le Parti de la liberté: «[…] l’extrême droite est divisée en deux camps: national socialiste et libéral nationaliste. Le premier est représenté par les Démocrates suisses et le second par le Parti des automobilistes. […] Alors que le Parti des automobilistes est d’accord avec les Démocrates suisses dans leur opposition à la surpopulation étrangère – ce dernier est à l’origine de neuf référendums et initiatives anti-étrangers depuis 1970 – et le refus d’une participation suisse aux organisations internationales, il est en désaccord sur leur vision de l’économie et de l’Etat.»Le Parti des automobilistes a fait élire jusqu’à huit parlementaires au parlement national (sur 200) et jusqu’à dix dans certains parlements cantonaux alémaniques. Gentile, Pierre, Kriesi, Hanspeter (1998), «Contemporary Radical Right Parties in Switzerland: History of a Divided Family», in The New Politics of the Right-Neo-Populist Parties and Movements in Established Democracies, Londres, MacMillan, pp. 125-143.
- Dans son important ouvrage publié en 1965, Choay, Françoise (1965), L’urbanisme, utopies et réalités: une anthologie, Paris, Seuil.
- C’est l’ingénieur Ildefons Cerdà qui introduisit le néologisme urbanización en 1867, pour désigner ce qu’il conçoit être une science de l’organisation spatiale des villes.