The Pedestrian (Le Piéton) est une nouvelle écrite en 1951 par l’auteur de science-fiction Ray Bradbury, connu pour ses Chroniques martiennes et pour son roman dystopique Fahrenheit 451, porté à l’écran par François Truffaut.
The Pedestrian
PÉNÉTRER dans ce silence – celui de la ville à huit heures d’une soirée brumeuse de novembre -, fouler l’asphalte gondolé des rues, marcher sur l’herbe qui avait poussé entre les fissures et, les mains dans les poches, s’ouvrir un chemin à travers les silences environnants, c’était la plus grande joie de M. Léonard Mead. Il aimait s’arrêter à un croisement, scruter dans quatre directions les longues avenues éclairées par le clair de lune, décider du chemin à prendre (ce qui à vrai dire n’avait que peu d’importance: dans ce monde de l’an 2052, il était un homme seul, ou peu s’en fallait) puis, la direction choisie, se mettre en marche à grands pas et lancer devant soi de grandes bouffées d’air glacé, semblables à la fumée d’un cigare.
Il marchait parfois pendant des heures, pendant des kilomètres et ne revenait chez lui qu’autour de minuit. Chemin faisant, il regardait les villas, les maisons avec leurs fenêtres obscures, et cela ressemblait assez à la traversée d’un cimetière où seuls les lumignons des feux follets s’éclairaient derrière les fenêtres. Parfois, il lui semblait que des fantômes grisâtres se mouvaient sur les murs intérieurs des pièces dont on avait oublié de tirer les rideaux, ou bien il entendait des chuchotements et des murmures lorsque était restée ouverte la fenêtre d’un de ces édifices qu’il comparait à des monuments funéraires.
Alors M. Léonard Mead s’arrêtait, redressait la tête, écoutait, regardait, puis reprenait sa marche à pas silencieux sur la route blanche. Car, depuis longtemps déjà, il avait décidé de chausser, pour ses promenades nocturnes, des souliers à semelles souples ; le bruit que faisaient les semelles dures éveillait en-effet les chiens qui accompagnaient sa marche de leurs aboiements intermittents pendant que des lumières éclataient, que des visages apparaissaient et que toute une rue se réveillait sur son passage ; car il n’y avait que lui dehors en cette soirée du début novembre.
Il avait commencé ce soir-là sa promenade en allant vers l’ouest, dans la direction de la mer. L’air était glacé, pur comme du cristal ; il vous coupait le souffle et faisait brûler les poumons comme un joyeux arbre de Noël : on pouvait sentir la flamme glacée pénétrer et ressortir, vous emplissant les bronches d’une neige invisible. M. Léonard Mead écoutait le léger crissement de ses souliers souples foulant les feuilles d’automne et il sifflait entre ses dents, d’un sifflement calme et léger ; de temps à autre, il cueillait une feuille dont il examinait, à la lumière des rares lampadaires, le réseau de nervures et il respirait son parfum rouillé tout en continuant de marcher.
« Holà ! là-bas, murmurait-il en passant devant les maisons. Quoi de nouveau ce soir sur la quatrième Chaîne, sur la septième, la neuvième ? De quel côté s’élancent à présent les cow-boys ? Verra-t-on enfin la Cavalerie des États-Unis apparaître en haut de la colline la plus proche pour nous secourir ? »
La rue était silencieuse, vide à perte de vue, seule son ombre bougeait comme l’ombre d’un épervier à l’intérieur des terres. S’il fermait les yeux et restait immobile, il pouvait s’imaginer au milieu du désert de l’Arizona, froid, sans un souffle de vent, sans une habitation à mille lieues alentour, sans autre compagnie que les lits desséchés des rivières, les rues.
« Quelle heure est-il, à présent ? demanda-t-il aux maisons, et il consulta son bracelet-montre. Huit heures trente ? L’heure d’une bonne petite douzaine de crimes bien assortis ? L’heure du sketch comique ? On passe une revue ? Un comédien sort de scène ? »
Était-ce l’écho d’un éclat de rire qui fusait à présent d’une des maisons blanches dans le clair de lune ? Il hésita un moment, puis, comme rien n’arrivait, il continua son chemin. Il trébucha sur un coin de trottoir particulièrement abîmé. L’asphalte disparaissait sous les fleurs et l’herbe. Depuis dix ans qu’il se promenait ainsi, de jour et de nuit, accumulant les kilomètres par milliers, il n’avait jamais rencontré un autre promeneur, jamais un seul au cours de ces longues années.
Il arriva à un carrefour en patte d’oie, silencieux, au croisement de deux voies express qui traversaient la ville. Pendant le jour, c’était la houle tonnante des voitures, les stations d’essence ouvertes, un bourdonnement de gros insectes, une lutte serrée de scarabées glissant vers des destinations lointaines, cherchant à se dépasser, à se faufiler dans une meilleure position, une légère fumée d’encens s’élevant de leurs tuyaux d’échappement. Mais, à présent, ces grandes artères aussi, pareilles à des torrents pendant la saison sèche, étaient des lits de pierre qu’illuminait le clair de lune.
Il prit pour revenir une rue latérale, tournant dans la direction de sa maison. Il n’avait plus que quelques pas à faire pour arriver chez lui, quand la voiture solitaire tourna brusquement le coin de la rue, et dirigea sur lui son faisceau de lumière aveuglante. Il s’arrêta ébloui, étourdi comme un papillon de nuit par un phare, puis il avança vers elle.
Une voix métallique le héla :
« Halte ! Restez où vous êtes ! Ne bougez pas ! »
Il s’arrêta.
« Levez les mains ! Ou nous tirons ! »
La police évidemment, mais quelle chose insolite, incroyable : dans une ville de trois millions d’habitants, il n’y avait plus qu’une seule voiture de police : n’était-ce pas naturel ? L’année précédente, 2052, l’année des élections, la police s’était vu enlever deux de ses trois voitures. La criminalité avait baissé. Plus besoin de police, sauf cette dernière voiture qui errait sans fin dans les rues vides.
« Votre nom ? » entendit-il dans un murmure métallique. Il ne pouvait voir l’homme à cause du réflecteur puissant dirigé sur lui.
« Léonard Mead.
– Plus fort !
– Léonard Mead !
– Emploi ou profession ?
– Disons écrivain.
– Sans profession », dit la voix sortant de la voiture, comme si elle parlait pour elle-même. La lumière le clouait sur place comme un spécimen dans une vitrine de musée, le corps transpercé d’une épingle.
« Vous pouvez le dire », fit M. Mead. Il n’avait plus écrit une ligne depuis des années. Les revues, les livres ne se vendaient plus. Tout se passait, dès la tombée de la nuit, dans ces maisons pareilles à des caveaux. Des caveaux vaguement éclairés par la lumière de la télévision, où les gens reposaient comme des cadavres, où la lumière grise ou multicolore atteignait leurs visages sans jamais les atteindre eux-mêmes réellement.
« Sans profession, reprit plus fort la voix métallique. Que faites-vous dehors ?
– Une promenade, dit Léonard Mead.
– Une promenade !
– Une simple promenade, dit-il calmement, mais il sentait son visage se glacer.
– Promenade, simple promenade ? Une promenade ?
– Oui.
– Promenade pour aller où ? Pour faire quoi ?
– Pour prendre l’air. Une promenade pour voir.
– Votre adresse !
– 11, South St. James street.
– Il y a de l’air dans votre maison, de l’air climatisé, M. Mead ?
– Oui ;
– Et vous avez un écran de télévision à votre disposition ?
– Non.
– Non ? » On entendit un léger crépitement qui était comme une mise en accusation.
« Êtes-vous marié, monsieur Mead ?
– Non.
– Pas marié », dit la voix du policier derrière le faisceau aveuglant. La lune était haute et brillante parmi les étoiles et les maisons grises et silencieuses.
« Personne n’a voulu de moi, dit Léonard Mead, avec un sourire.
– Ne parlez que si on vous interroge ! »
Léonard Mead attendit dans la nuit froide.
« Simple promenade, monsieur Mead ?
– Oui.
– Mais vous n’avez pas dit dans quel but.
– Je l’ai dit ; prendre l’air, voir, me promener simplement.
– Avez-vous fait ça souvent ?
– Chaque soir, depuis des années. »
La voiture de la police restait immobile au milieu de la rue, l’appareil de radio bourdonnant légèrement dans son ventre.
« C’est bien, monsieur Mead.
– Est-ce tout ? demanda-t-il poliment.
– Oui, répondit la voix. Là. » On entendit comme un soupir, un déclic. La porte arrière de la voiture s’ouvrit brusquement. « Montez.
– Attendez un peu, je n’ai rien fait !
– Montez.
– Je proteste !
– Monsieur Mead ! »
Il avança semblable, tout à coup, à un homme ivre. En dépassant la cabine du chauffeur, il regarda à l’intérieur. Comme il s’y attendait, elle était vide ; dans la voiture, il n’y avait âme qui vive.
« Montez ! »
Il s’appuya contre la porte et regarda la banquette arrière ; c’était une cellule en miniature, une petite prison grillagée obscure, Cela sentait l’acier ; cela sentait l’antiseptique ; cela sentait la propreté dure du métal. Il n’y avait pas la moindre douceur là-dedans.
« Eh bien, si vous aviez une femme pour fournir un alibi, reprit la voix métallique. Mais…
– Où m’emmenez-vous ? »
La voiture hésita, ou plutôt on entendit à l’intérieur une suite de déclics, comme si une machine à poinçonner demandait des informations à un œil électronique. « Au Centre psychiatrique de Recherches sur les Tendances régressives. »
Il monta. La porte se referma avec un léger bruit sourd. La voiture de police roulait codes allumés à travers la ville endormie.
Un instant plus tard, dans une des rues de cette ville obscure, ils passèrent devant une maison ; une parmi tant d’autres, mais elle avait ceci de particulier qu’elle était éclatante de lumière, que chacune de ses fenêtres, carré de chaleur dans la nuit froide, était une source vive de clarté.
« C’est ma maison, » dit Léonard Mead.
Il n’y eut pas de réponse.
La voiture avançait le long des trottoirs déserts, dans les rues désertes comme dans le lit d’une rivière à sec ; et nul bruit, nul mouvement ne troubla plus la tranquillité de cette nuit froide de novembre..
Ray Bradbury, The Pedestrian.
Traduit par RICHARD NEGROU.
Traduction: « Le promeneur » et « L’arriéré »
Source: https://urbabillard.wordpress.com/
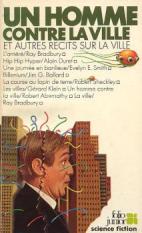
Notes complémentaires:
Si l’État interdit à l’individu le recours à l’injustice, ce n’est pas parce qu’il veut supprimer l’injustice, mais parce qu’il veut monopoliser ce recours, comme il monopolise le sel et le tabac.
FREUD, Essais de psychanalyse.
La rébellion est un thème éternel. Elle est devenue un problème, pour les écrivains de S. -F., autour de 1950. C’est l’époque où là vague de la télévision balaie les USA. ; les intellectuels s’inquiètent de voirles gens rester chez eux devant le petit écran, oublier leur mobilité, leur sociabilité et – croient-ils – leur liberté. La mutation réactive un vieux fantasme américain (la peur du conformisme ambiant) en même temps qu’elle paraît justifier les avertissements des anti-utopistes : le futur entre dans le présent: le cauchemar fait irruption dans le réel. La vidéocommunication, autant que la bombe atomique, marque l’entrée dans une ère nouvelle et donne à la Science-fiction de ce temps une coloration hyperréaliste que la génération précédente n’annonçait guère. Le monde passe de trois à deux dimensions; l’humanité perd toute épaisseur; les institutions et notamment la police deviennent presque inutiles. Il n’y a plus de rebelles, seulement des déviants; plus de prisons, seulement des hôpitaux psychiatriques. Et pour ceux qui ne sont pas tout à fait dans les normes, une immense, une complète solitude.
RICHARD NEGROU







Souvent la réalité rejoint la fiction et cette nouvelle de Bradbury n’est pas très éloignée d’une anecdote vécue par le philosophe Günther Anders aux USA, probablement au début des années 1950…
http://carfree.fr/index.php/2009/10/02/whats-the-matter-with-your-car/
Trop fort, Ray ! tu avais tout compris ! Et su le raconter. ..
la littérature reste une technique redoutable pour déconstruire les systèmes de valeurs hégémoniques et les représentations mentales qui les accompagnent…
dommage simplement que nous vivions une époque où les écrivains et écrivaillons seraient plus nombreux que les lecteurs…
mais que ça ne décourage pas notre petite communauté pour s’essayer à la chose, et en attendant chapeau bas à celles et ceux qui , comme Ray Bradbury ou Günther Anders, ont réussi à faire comprendre ce qui peut y avoir de nécro sociétal dans le système automobile…
toujours intéressant,
la bonne littérature.
Sur un ton plus humouristique, il existe une nouvelle de Fredric Brown que j’aime bcp :
Un personnage, que j appellerai « L Auteur », donc « A » (simplement car « Orateur » ne s’écrit pas Aurateur..) , qui va chercher un « B », un « Bidule » dans un magasin (une machine à écrire, ou un livre).
Il passe pour quelqu’un de bizarre, car il n a pas de « C », de « Chose » (un ordi + imprimante? face à la machine à écrire; ou une télé, face à un livre ?),
Forte hostilité de la foule, autour du vendeur/du vigile et de A, face à cet original qui n a pas de « chose« .
Pour éviter que A ne soit lynché par la foule, le vigile le fait venir dans un local retiré.
Et là, A répond à ses questions, et dit qu’il préfère la machine à écrire/le livre, pour convenance personnelle, et il explicite ses raisons.
Le vigile dit qu’il comprend, mais que, pour le trouble à l’ordre public, pour la foule déchainée qui s’était amassée autour de lui, il lui demande son permis de conduite, (et son numéro de tél, pour vérifier chez lui qu’il n est pas un agent provocateur/fou/délinquant/évadé d asile/autre personne sujette à différence, et à problèmes pour un vigile).
Il dit qu’il n a pas de permi, car il n a pas de voiture.
(et il dit qu’il n a de tél, car il préfère aller voir les gens directement, pour leur parler en face).
Contrairement à la foule, le vigile (flic?) était calme, et semblait compréhensif… jusque là !
Mais là ..
« Mais, si vous n’avez pas voiture, comment êtes-vous venu dans ce Mall, dans cet hypermarché ? »
et A répond : je suis venu en taxi.
Et là, le vigile explose : quoi ! vous refusez de passer votre permis, vous refuser d acheter une voiture, et vous forcez les autres à le faire pour vous ? Mais, si tout le monde faisait comme vous, à faire ce qui lui plait.. mais, la société s’écroulerait !
Puis il continue un peu à dérouler les conséquences désastreuses qui en découleraient (moins de pollution, plus de lien social avec des vies de quartiers, moins de délinquance et de suicides, moins de gaspillage de matière et d’énergie, plus d’emplois locaux non délocalisables.. c.f. http://www.manicore.com/documentation/sobriete.html => Que des horreurs, quoi..)
(De nos jours, celà marcherait aussi avec le téléphone portable :
Quelqu’un qui n en a pas, et qui préfère parler aux gens autour de lui, plutôt que de les ignorer, et de jouer à des jeux, ou être en « communication » avec des gens lointain
Alors, si la personne, n a ni télé, ni ordi, ni imprimante, ni voiture, ni téléphone, ni téléphone portable (mais des livres-revues-journaux, des crayons-cahiers-feuilles, un vélo, et une voix et des oreilles), manquerait plus qu’elle mange bio et soit végétarienne, pour qu’on la crucifix ou la lapide sur la place publique..
==
Bon.. la vraie nouvelle de Fredric Brown est mieux que ma retranscription de mémoire… et elle peut même se lire facilement en VO, en anglais : elle est d’un niveau très accessible (niveau 3ème – 2nde ?)
Par contre, je n ai ni titre, ni le nom du recueil de nouvelles dans lequel on peut la lire (ni lien direct vers cette nouvelle, non libre de droit).
Cependant, plus que Ray Bradbury, Günther Anders ou Fredric Brown, il y a une personne que je voudrai féliciter pour sa prause :
Pédibus, pour le commentaire juste au dessus du mien.
Un texte mieux accessible, une forme simple, mais bien mieux et plus intéressante, que tes pompes à phynances récurrentes (bien que je connaisse Ubu – Jarry, et que les clins d’oeil-clichés, c est pas de la merdre, celà ne doit pas rendre le texte peu accessible : on doit pouvoir lire sans avoir les références).
Je ne sais plus si c était toi, mais je crois bien,
j avais aussi apprécié ton (?) inventaire à la Prévert, ou plutôt, à la San Antonio, il y a qq semaines, mais il avait moins de justesse, de pertinence que ton commentaire d’au-dessus.