Voici un extrait du livre de José Ardillo, « Les illusions renouvelables, » intitulé « le mythe de l’automobilité. »
Le mythe de l’automobilité
Symbole pour beaucoup de la guerre impérialiste, l’automobile est paradoxalement l’un des éléments qui a apporté la paix en Occident – ou plus exactement une forme de pacification. À partir de la Seconde Guerre mondiale, la classe ouvrière en Europe et aux États-Unis a peu à peu commencé à avoir accès au commerce normalisé de marchandises : logements urbains, appareils électroménagers, boissons, nourriture industrielle, cinéma, télévision et, surtout, automobile et moyens de transport motorisés intégrés dans un réseau routier en constante expansion.
Il est difficile d’estimer jusqu’à quel point la mobilité offerte par les véhicules personnels a servi de moyen de compensation pour de vastes couches de la population. L’automobile est associée à une forme de liberté dans le monde actuel, car elle confère aux individus un moyen de se déplacer aisément d’un endroit à un autre dans un laps de temps relativement court. L’ère moderne a ainsi rendu possible le développement du mouvement à un niveau inédit.
L’automobile peut-être conçue comme un vecteur à la fois de guerre et de paix. D’une certaine manière, la structure sociale et économique de l’automobilité serait l’arrière-plan d’une guerre mondiale pour le contrôle des ressources énergétiques et des matières premières. La paix sociale en Occident repose en grande partie sur l’expansion d’une économie intérieure, laquelle serait inenvisageable sans un réseau de transport motorisé tel que le nôtre. Bien qu’il soit impossible d’ignorer tout cela, on en tire rarement toutes les conséquences. Dans un ouvrage récemment traduit en français, Hosea Jaffe, après l’évocation de quelques lieux communs sur la relation entre automobile, pétrole, désastre écologique et guerre internationale, dresse le constat suivant : « Dans les années à venir, se déconnecter d’un complexe industriel pétrole-automobile sera à la fois nécessaire et révolutionnaire (1). » Quand bien même l’auteur de ce texte reste attaché au jargon tiers-mondiste des années 1960, il reconnaît tout de même que l’attente d’une solution de remplacement de la vieille automobile à pétrole par la voiture électrique – ou par une autre technologie – pourrait être frustrée par la pénurie des ressources qui secouera prochainement le monde. Il reste à savoir s’il est judicieux de séparer la critique de l’automobile, c’est-à-dire de la mobilité privée, de celle de la mobilité et du transport en général, comme le fait cet auteur qui semble bien trop optimiste à l’égard des possibilités offertes par le transport collectif.
En parallèle, le développement de l’automobile a été essentiel pour fiscaliser une activité aussi rudimentaire que le déplacement. En faisant du déplacement une norme, le transport était désormais valorisé et donnait naissance à une nouvelle forme d’économie, repoussant ses limites. Les fondements de l’automobile reposent en grande partie sur la concentration productive, la planification urbaine et la spécialisation professionnelle. Ce n’était cependant qu’un premier pas pour l’automobile. En effet, rappelons que dans les grands centres urbains et ouvriers, les transports motorisés étaient au départ en grande partie collectifs. Néanmoins, à partir de Ford, s’ouvrit l’ère de l’automobile individuelle, grand bond anthropologique qui culminera dans les années 1950 avec l’extension de l’utilisation de la voiture aux jeunes et aux adolescents, l’apogée de la publicité pour la vente de véhicules, les grands embouteillages, la pollution, les statistiques sur les accidents de la route, etc.
En 1958, l’historien Lewis Mumford tirait la sonnette d’alarme au sujet des dangers patents de la motorisation aux États-Unis. Il affirmait : « Quand le peuple américain, par le biais du Congrès, a voté récemment – en 1957 – un programme de construction d’autoroutes pour un montant de vingt-six millions de dollars, on ne peut qu’éprouver de la compassion en supposant que par cet acte il n’avait pas la moindre idée de ce qu’il faisait. Dans quinze ans il s’en rendra sûrement compte ; mais alors il sera trop tard pour corriger l’étendue des dommages que ce programme, mal conçu et extrêmement déséquilibré, aura causés dans nos villes et nos campagnes (2). » Et d’ajouter : « L’actuel mode de vie américain s’appuie non seulement sur le transport motorisé mais aussi sur la religion de la voiture, et les sacrifices que les personnes sont prêtes à faire pour cette religion dépassent les limites de la critique rationnelle. Tout ce que l’on pourrait faire pour que le peuple américain recouvre la raison serait sans doute de démontrer clairement que son programme d’autoroutes balaierait le même espace de liberté que la voiture individuelle promettait de leur accorder. »
À la fin des années 1950, Mumford observait avec inquiétude l’expansion dévastatrice des villes américaines, qui se développaient de façon irrationnelle à l’intérieur des circuits de déplacement motorisé, ainsi traversées ou contournées par des réseaux d’autoroutes qui les transformaient en enfers invivables. L’essor du transport automobile s’était fait en dépit du bon sens, transformant le transport en une énième nécessité de l’ère industrielle. En réformateur humaniste, Mumford caressait toujours l’espoir que la culture urbaine pourrait se combiner à un habitat rural et paisible, que l’acte de marcher ne serait pas proscrit ou marginalisé par les autres moyens de transport.
Il convient de rappeler que ce fut également à cette époque que parut aux États-Unis le mémorable roman Sur la route (1957) de Jack Kerouac, récit effréné d’une partie de la vie de l’auteur aux côtés de certains de ses amis. Ces pages décrivaient pour la première fois la relation entre la liberté et la mobilité qui caractérisait la nouvelle génération. Le roman relate les déplacements « côte à côte » effectués sans relâche par un groupe de jeunes se sentant en marge d’une société qui, toutefois, les avait condamnés à la mobilité. C’est à cette époque qu’est né le mythe d’une autonomie considérée comme une opportunité pour se déplacer de façon ininterrompue. Il faudra attendre plusieurs années pour crier gare à un piège fatal dans lequel étaient tombés les habitants déracinés des nouvelles villes industrielles aux États-Unis. Dans l’un de ses derniers ouvrages, ce même Kerouac plein d’amertume, réactionnaire et alcoolique, se lamentait sur la déshumanisation créée par la vie industrielle et mécanisée de son cher pays : « Dis-moi une chose : pourquoi les gens d’aujourd’hui marchent les épaules baissées en traînant les pieds ? L’automobile les a-t-elle emplis de tant de vanité pour qu’ils marchent comme une bande de gorilles fainéants sans destin concret (3) ? »
Cinquante ans après Mumford et Kerouac, on peut voir que les routes ont continué leur expansion irrationnelle dans les villes. La concentration des services a continué de se renforcer, tandis que les villes sont devenues immenses, absorbant les quartiers et les villages situés en périphérie, augmentant la complexité des réseaux d’accès et transformant les espaces urbains en lieux invivables. Si nombre de nos anciens problèmes n’ont pas été résolus, d’autres se sont encore ajoutés à la liste.
La critique écologique de l’automobile et des transports motorisés est plombée par ce que nous qualifierons de « planification acceptable ». C’est-à-dire que face aux abus et aux excès causés par le transport automobile dans nos vies et notre environnement, on propose des mesures partielles ou des palliatifs, sans soulever les questions de fond. Ou à l’inverse, on évoque des solutions globales visant des objectifs radicaux, mais qui dépendent toujours de l’omnipotence technologique. C’est l’objet de l’une des premières études critiques sur la mobilité, le transport et l’automobile, publiée au début des années 1970 par l’activiste écologiste Patrick Rivers (4). Il mentionne une série de propositions tirées du manifeste « Blueprint for survival » (The Ecologist, vol. 2, n°1, janvier 1972), dont la « création d’un nouveau système social ». En premier lieu, il est plutôt drôle de voir que la création de ce nouveau système s’ajoute à une liste de propositions déjà bien remplie… alors qu’elle est celle dont toute autre mesure ou suggestion devrait être tributaire. En effet, comment peut-on parler du rétablissement de l’équilibre démographique ou du changement de l’économie de ressources dans ce système social ? La possibilité d’une transformation technique, économique et organisationnelle nous renvoie sans cesse vers la terra incognita d’une révolution, qu’il est impossible de concevoir pour le moment. Rivers écrivait : « L’impact qu’aurait une décentralisation sur les transports et les voyages serait impressionnant. Avec une industrie et une agriculture locales, les distances au sein de la communauté diminueraient ainsi que les besoins en transport de marchandises entre les villes. Avec la planification d’une communauté compacte, on pourrait faire la majeure partie des trajets à pied ou en transport public. » Il suppose par ailleurs que cette décentralisation d’envergure serait accompagnée d’une profonde révolution technologique, notamment dans les télécommunications, qui parachèverait cette utopie d’une société à mobilité raisonnable: « Le perfectionnement des télécommunications pourrait soulager la pression dont souffre Londres et d’autres grandes villes en tant que sites privilégiés pour établir le siège de tout type d’organisation, gouvernementale, industrielle, éducative. » Manifestement, l’écologie n’a jamais réussi à se libérer de la force d’attraction du pouvoir ; elle est toujours aussi incapable de concevoir que l’organisation sociale puisse prendre une direction qui ne soit pas concentrique. Ainsi, la contradiction d’une culture matérielle soutenue massivement par des réseaux « immatériels » de traitement de l’information demeure le grand défi que doivent relever les nouveaux réformateurs sociaux, parmi lesquels figurent entre autres les actuels représentants de l’« écologie sociale ». Voici un extrait d’un récent dossier traitant de la question : « Il est normal que l’État garantisse le droit à la mobilité grâce à un système de transport public adapté aux personnes les plus démunies (5). » Plus loin, l’auteur cite quelques « expériences de restriction de l’utilisation de la voiture en ville », à l’image de Munich, Oslo, Amsterdam, Berlin, Rome, Bologne, Copenhague, Vienne, etc. Selon lui, toutes ces villes ont pris le parti de la limitation du trafic automobile et de la fluidification de la circulation.
Ces propos tendent à démontrer que l’écologisme confie les rênes à l’État pour prendre en main le changement dans la vie collective. Par ailleurs, le fait que cette liste présente des villes parmi les plus riches du monde – et qui sont de véritables centres du pouvoir bancaire et bureaucratique – comme exemples de limitation d’une automobilité abusive est très révélateur de l’imaginaire écologiste d’aujourd’hui. En réalité, les perspectives sont terrifiantes : pour les écologistes, seuls l’État et le néocapitalisme centralisé ont les moyens d’agir en vue d’une transformation sociale.
Pour conclure, la critique du transport et de l’automobile est inséparable de la critique de l’État, du centralisme productif, de la technologie industrielle et de la vie quotidienne. Par conséquent, réinventer le transport et la mobilité implique un sérieux questionnement non seulement de notre mode de vie, mais aussi des mesures que nous prendrons pour opérer un changement social radical. L’écologisme d’État, l’écologisme fasciné par le capitalisme environnemental des pays riches et l’écologisme de la planification constituent aujourd’hui un énorme obstacle pour envisager de nouvelles perspectives d’action et d’organisation collective opposées aux tendances destructrices actuelles.
Du point de vue énergétique, l’automobilité se révèle incompatible avec notre survie à long terme. Mumford vantait toutefois les mérites – non sans une certaine naïveté – des voitures électriques de petite taille. Mais la question cruciale demeure de savoir si l’automobilité n’est rien d’autre qu’une nécessité supplémentaire créée de toutes pièces, au coût impondérable. Le fait que cette machine porte le nom d’« automobile » ne manque pas d’ironie, lorsque l’on sait que de tous les moyens de transport de l’histoire humaine, il s’agit probablement du moins autonome. En effet, l’« automobile » en tant que simple artefact s’inscrit dans un ordre technique et économique qui nécessite une incroyable mobilisation de forces matérielles, politiques, techniques, législatives, etc., pour pouvoir circuler sur les routes. Sa capacité de mouvement autonome est une fiction qui a nécessité la transformation du monde pour la rendre crédible. L’expansion de la voiture s’accompagne d’une violence croissante dans la vie sociale et économique (pollution mortifère, accidents, guerre, inflation, gaspillage énergétique, aliénation). Autrement dit, à mesure que l’usage de l’automobile s’ancre dans la vie quotidienne des populations, la spirale d’absurdités menaçantes de l’économie politique de l’automobile se développe, sans tenir compte du fait que les coûts qui s’accumulent ne sont pas externes, mais renforcent le caractère suicidaire de la mobilité et du transport de la société contemporaine. Plus nous faisons un usage quotidien, proche, familial et pratique de l’automobile, plus nous portons des œillères qui nous empêchent de voir sa nature destructrice. La mobilité fictive qu’elle nous offre dissimule la dangerosité et la dépendance de notre monde moderne, soumis aux impératifs despotiques de cette autonomie. L’énergie déployée dans le transport des personnes et des marchandises représente également une ineptie sociale et économique totale ; mais étant donné que cette énergie provient de sources tarissables, une telle absurdité est encore plus criante dans la mesure où l’élément moteur de l’activité économique, le transport motorisé, a un avenir plus que sombre.
Il est aujourd’hui banal de constater que sa participation très importante à la pollution de la biosphère balaie tous les doutes qui pourraient encore subsister quant à la « rentabilité » de ce moyen de transport. L’automobile n’est pas le fruit d’un besoin commun, agréé par tous et rationnel, qui émanerait d’une société déterminée ; il s’agit seulement d’un luxe que se sont offert les populations de certains pays développés non seulement en pillant d’autres populations et zones naturelles, mais aussi au prix de leur propre aliénation à un objet de consommation de luxe.
L’automobilité a été le privilège d’une société enivrée de pouvoir ; elle a provoqué une guerre qui a duré un peu plus d’un siècle et qui n’a fait qu’accroître les inégalités sociales et la détérioration physique de l’environnement. Même si le règne de l’automobilité peut encore durer quelques décennies, son avenir est incertain : malgré les efforts d’une propagande apologétique, l’automobile a presque achevé sa course folle vers sa propre destruction (hausse des prix du carburant et chaos environnemental avant tout). L’automobile a été la machine de guerre qui a permis à l’Occident de prospérer dans un climat de paix insensée et d’indulgence avec soi-même : la paix du « week-end » et de l’escapade routière jusqu’à la plage ou la montagne, placée sous le contrôle armé de pays lointains.
L’expansion de l’automobile a certes renforcé un mode de vie qui se tient toujours plus à distance des effets de l’économie de guerre, dont il a pourtant besoin pour se maintenir. Mais toutes ces contradictions ne manqueront pas d’être dévoilées au grand jour dans les années à venir.
Les Illusions renouvelables
Énergie et pouvoir : une histoire
José Ardillo
Traduit de l’espagnol par Pierre Molines, Nicolas Clément et Henri Morat
Éditions l’échappée
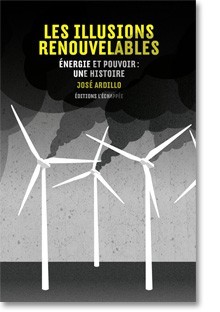
Notes
(1) Hosea Jaffe, Automobile, pétrole et impérialisme, Parangon, 2005.
(2) Lewis Munford, The Highway and the City, Mentor Books, 1964.
(3) Jack Kerouac, La Vanité de Duluoz, Christian Bourgois, 1996.
(4) Patrick Rivers, Restless Generation. A Crisis in Mobility, Davis-Poynter, 1972.
(5) Traduit de l’article « Alternativas al coche » écrit par l’un des membres de Ecologista en Accion et publié dans un conglomérat de revues : La Lletra A, Ecologista y Libre Pensamiento, hiver 2006-2007.






Oui Mumford n’a pas été complètement carfree dans son raisonnement, particulièrement en considérant comme une des solutions aux effets nécrosociétaux de l’automobile et de son $ystème l’utilisation de véhicules de petite taille… Sans doutes était-il trop imprégné de culture américaine?
Faut-il voir également à l’origine des mythes de l’automobilité la distinction qui a toujours été recherchée, avec une technique propre à chaque époque, dès qu’il s’agissait de se déplacer?
Ainsi de l’hippomobilité, apparue en même temps que l’histoire, avec les « inventions » de la ville, de l’écriture et de l’Etat – carré magique des sociétés centralisées, bureaucratiques, liberticides, en commençant il y a cinq millénaires avec les cités-Etats mésopotamiennes -, puis « raffinée » avec le carrosse à la période classique – déjà cinq mille véhicules dans les Provinces Unies… – et finalement la gnognole massifiée avec le fordisme et un système économique à la mercatique pilotée par le désir, où la « distinction » se cantonnera aux seules couleurs, formes et marques de carrosseries :
beau progrès en effet pour la plèbe embouteillée incarcérée couillonnée…
En espérant une très prochaine distinction massifiée, grâce à une rapide diffusion, par contagion avec l’intermédiaire du face-à-main électronique, le téléphone portable ensemençant l’imaginaire de récits où il sera question de trajets quotidiens pédestres, cyclistes, en tram ou en train.
Il y aura même une fin honorable pour nos kapitalisses, en leur confiant le beau boulot du démantèlement du système précédant. Enfin si on souhaite lisser la transition, et sans oublier de reprendre les manettes localement au moment opportun.